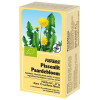Pissenlit : Bienfaits, utilisations et danger
Sommaire
- Nom latin ou botanique
- Autres noms
- Vertus traditionnelles
- Quelles parties sont utilisées en phytothérapie ?
- Description botanique
- Où trouver du pissenlit ?
- Comment le cultiver et le récolter ?
- Quels sont ses usages reconnus ?
- Comment le prendre ou l'utiliser ?
- À quelles autres plantes médicinales l'associer ?
- Quelles sont les précautions ?
Les racines de Pissenlit pour votre bien-être digestif, hépatique et votre taux de sucre
- Pour la peau et le foie : Recommandées en cas de problèmes de peau et troubles du foie liés à un excès de toxines, les racines de pissenlit ont des propriétés dépuratives et détoxifiantes hépatiques.
- Pour la digestion : Les racines de pissenlit aident en cas d'indigestion, de ballonnements et préviennent les calculs biliaires, grâce à leurs propriétés cholagogues, cholérétiques et stomachiques.
- Pour le poids et la cellulite : La tisane de racine de pissenlit peut aider à lutter contre les hémorroïdes, l'embonpoint et la cellulite grâce à ses propriétés légèrement laxatives et dépuratives.
- Pour la glycémie : Les racines de pissenlit ont des propriétés hypoglycémiantes et prébiotiques, grâce à l'inuline qu'elles contiennent, qui semble réduire l'absorption du glucose par les intestins et abaisser le niveau de glucose dans le sang.
Les feuilles de pissenlit possèdent des propriétés diurétiques, alcalinisantes, toniques amères et litholytiques urinaires.
- Elle contient des vitamines A, B, C, D et K, ainsi que des acides aminés, du potassium et des caroténoïdes.
- Pour prévenir les calculs rénaux et traiter les œdèmes ou la rétention d'eau : Grâce à sa forte teneur en potassium, la plante de pissenlit restitue au corps le potassium perdu dans l'urine, son un effet diurétique plus prononcé que les racines.
- La plante de pissenlit peut également servir à stimuler l'appétit. Comme, elle est considérée comme tonique amère, elle peut favoriser la digestion et améliorer le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire.
Nom de la plante : Pissenlit.
Famille botanique : Le pissenlit appartient à la famille des Astéracées.
Quel est son nom latin ou botanique ?
Le nom latin du pissenlit est Taraxacum officinale ou Taraxacum dens leonis.
Quels sont les autres noms du pissenlit ?
On retrouve parfois le pissenlit sous les noms suivants : chopine, couronne de moine, florin d’or, salade de taupe, dent de lion, liondent et fausse chicorée.
Bienfaits et vertus traditionnelles
Le pissenlit taraxacum contient des flavonoïdes et des terpènes, il regorge de bienfaits santé. En effet, cette plante riche en vitamines A, B, C, D et K.
Les feuilles contiennent des acides aminés, des minéraux, notamment du potassium et des caroténoïdes.
La racine contient également des minéraux tels que du potassium et du calcium, mais aussi des sucres et un hétéroside appelé le taraxacoside.
La racine est reconnue et utilisée pour ses vertus médicinales bénéfiques pour la santé, il agit comme tonique amer, cholagogue, cholérétique, détoxifiant hépatique, dépuratif, apéritif, stomachique, légèrement laxatif.
La racine est recommandée en cas de problèmes de peau ou en cas d'hépatite liés à un excès de toxines, en cas d'indigestion, de ballonnements, en prévention de calculs biliaires ou de cholécystite, elle peut être utilisée également pour lutter contre les hémorroïdes, l'embonpoint et la cellulite.
Enfin, la racine est hypoglycémiante, grâce à l'inuline qui semble réduire l'absorption du glucose par les intestins et abaisser le niveau de glucose dans le sang.
La feuille de pissenlit est réputée pour ses vertus diurétiques, alcalinisantes, apéritives, tonique amer, litholytique urinaire.
Grâce à sa richesse en potassium elle redonne au corps le potassium excrété dans l'urine. La feuille est conseillée en prévention des calculs rénaux et en cas d'œdèmes.
Enfin la feuille est plus diurétique que la racine.
Quelles parties de la plante sont utilisées en phytothérapie ?
En phytothérapie, on utilise les racines, les feuilles et les fleurs du pissenlit. Les racines sont récoltées en automne ou en hiver lorsque la plante a au moins 2 ans. Les feuilles sont récoltées au printemps avant la floraison.
Quelle est la description botanique du pissenlit ?
Le pissenlit est une plante herbacée vivace très commune dans l’hémisphère Nord de la planète. En effet, cette plante adore les zones fraîches et humides. Elle pousse naturellement dans les prairies, les champs, les jardins et les bords de chemins jusqu’à 2 000 mètres d’altitude.
Cette plante sauvage, considérée comme mauvaise herbe et que l’on trouve dans toutes les régions tempérées d’Europe présente une souche épaisse. Sa racine brun rougeâtre, pivotante et charnue peut descendre jusqu’à 50 centimètres dans le sol.
Ses feuilles vert pâle se développent en rosette, quasiment appliquée sur le sol. Longues de 15 à 20 centimètres sur environ 3 centimètres de large, elles sont découpées en lobes triangulaires irréguliers, dentelés, crochus et pointus. C’est à cette forme qu’elle doit son surnom “dent de lion”.
Les fleurs de couleur jaune doré sont portées par des tiges creuses remplies de latex, groupées en capitules solitaires. Les fruits sont des akènes réunis en un boule duveteuse avec de fines aigrettes soyeuses qui s’envolent au moindre souffle de vent.
Où trouver du pissenlit ?
Si vous souhaitez vous soigner naturellement par les plantes, vous pouvez récolter le pissenlit dans la nature. Vous pouvez également vous en procurer en pharmacie ou en herboristerie.
À l'herboristerie du Valmont, nous proposons le pissenlit bio en plante séchée (feuilles coupées, poudre de racine, racine coupée, plante coupée) pour la préparation de tisane de pissenlit, de baumes ou onguents thérapeutiques ou autres préparations médicinales. Nous proposons également le pissenlit sous forme d’ampoules, de tisanes, de jus et de teinture mère.
Comment cultiver et récolter le pissenlit ?
Il n’y a rien de plus simple que de cultiver du pissenlit. Vous pouvez le semer en bac de plantation ou directement en pleine terre. Pour commencer, semez les graines, recouvrez d’une fine couche de terre et tassez bien. Gardez la terre humide jusqu’à la germination.
Le pissenlit aime la terre riche en compost et en humus, mais aussi l’arrosage régulier. Il se développe de façon optimale s’il est toujours humide.
Une fois que le pissenlit (taraxacum) est bien solide, il peut être transplanté en pleine terre ou en pot plus grand. Le fait de mettre les plants en pot permet de les déplacer facilement au fil des saisons.
Attention aux pucerons et aux fourmis qui peuvent coloniser la plante. Les escargots apprécient ses feuilles tendres et peuvent aussi nuire à la plante.
Quels sont les usages reconnus de la plante médicinale de pissenlit ?
Foie et digestion : En relation avec ses propriétés cholagogues et cholérétiques
Il est recommandé en cas de troubles digestifs suivants :
- dyspepsie postprandiale avec flatulences, ballonnements, impression de plénitude gastrique ;
- mauvaise digestion des graisses ;
- cholestase chronique ;
- syndrome de l’intestin irritable ;
- constipation légère;
- manque d appétit.
Estomac : En relation avec ses propriétés eupeptiques
- anorexie, inappétence ;
- gastrite.
Œdème, cellulite et régime : En relation avec ses propriétés diurétiques :
- rétention hydrique, oligurie ;
- prévention des lithiases urinaires ;
- cellulite ;
- accompagnement des régimes amincissants et des diètes hyperprotéinées.
Articulations : En relation avec ses propriétés anti-inflammatoires
- affections rhumatismales (arthrose, goutte, etc.) ;
- poly arthralgies, myalgies, notamment liées à des troubles digestifs.
Problèmes de Peau : En relation avec ses propriétés traditionnelles
- pathologies cutanées telles que l’eczéma, le psoriasis, l’acné, etc.
Utilisation du pissenlit
Usages thérapeutiques en interne :
Décoction de la Racine
1 cuillère à café de pissenlit racine séchée et finement coupée pour une tasse de 25 cl d’eau froide. Faites bouillir la préparation pendant 3 minutes, laissez infuser pendant 15 minutes à couvert, hors du feu, puis filtrez. Buvez 1 à 3 tasses par jour, environ 30 minutes avant chaque repas.
Teinture mère
Pissenlit en Teinture mère, extrait fluide : 30 gouttes diluées avec un peu d’eau, 3 fois par jour.
Infusion des Feuilles séchées
1 cuillère à soupe de feuilles séchées pour une tasse de 15 cl. Faites bouillir l’eau, laissez infuser pendant 10 minutes à couvert et filtrez. Buvez 1 à 4 tasses par jour, tout au long de la journée.
Salade de feuilles fraiches
Vous pouvez cueillir les jeunes feuilles au printemps, juste avant la floraison, et les manger en salade.
Usages thérapeutiques en externe :
Suc frais de la feuille (latex)
Il peut être appliqué localement sur les verrues, en évitant les zones de peau saine.
Huile solarisée des Fleurs
Laissez macérer des fleurs de pissenlit dans un bocal et recouvrez-les d’huile végétale (olive, sésame ou jojoba). Exposez le bocal au soleil tous les jours pendant 3 semaines et filtrez la préparation. Appliquez localement sur les zones affectées par l’eczéma, l’acné ou les taches de vieillesse, mais aussi sur les articulations douloureuses en cas de rhumatisme.
Quelles plantes médicinales peuvent être associées au pissenlit ?
- En cas de surcharge toxinique, de surpoids, de surcharge métabolique ou pondérale : la bardane, le frêne, la reine-des-prés, la piloselle et l’artichaut.
- En cas de détox hépatique : le souci, la menthe poivrée, l’artichaut, le romarin, l’aspérule odorante, le curcuma, la chicorée sauvage et la bardane.
- En cas de constipation : le fenouil et la guimauve.
- En cas d’inflammations urinaires ou de cystite : la guimauve.
- En cas d’arthrite : le curcuma.
- En cas de problèmes de peau : l’ortie et la bardane.
Pissenlit : Danger et précautions à prendre
Le pissenlit ne présente aucune toxicité. Cependant, il doit être consommé avec modération en cas d’estomac fragile ou irrité.
Ne consommez pas de pissenlit en cas d’obstruction des voies biliaires.
Des cas rares de dermatite de contact ont été reportés au moment de la récolte. Cet effet indésirable est provoqué par les lactones sesquiterpéniques présents dans le latex.
Foire aux questions
Quels sont les bienfaits du pissenlit sur la santé ?
Le pissenlit offre plusieurs bienfaits pour la santé :
- Bien-être digestif et hépatique : Les racines de pissenlit ont des propriétés détoxifiantes et dépuratives pour le foie, et peuvent aider en cas de troubles du foie liés à un excès de toxines.
- Aide digestive : Elles facilitent la digestion en prévenant les indigestions, les ballonnements et les calculs biliaires grâce à leurs propriétés cholagogues et cholérétiques.
- Contrôle de la glycémie : Les racines contiennent de l'inuline, qui aide à réduire l'absorption du glucose par les intestins et à baisser le niveau de glucose dans le sang.
- Santé rénale et diurétique : Les feuilles de pissenlit ont des effets diurétiques qui aident à prévenir les calculs rénaux et à traiter les œdèmes ou la rétention d'eau.
- Nutrition : Le pissenlit est riche en vitamines (A, B, C, D, K), acides aminés, potassium et caroténoïdes, qui sont essentiels pour une bonne santé globale.
Quelles sont les contre-indications du pissenlit ?
Bien que le pissenlit soit généralement sûr pour la plupart des gens, il existe quelques contre-indications :
- Obstruction biliaire : Il ne doit pas être consommé en cas d’obstruction des voies biliaires, car il stimule la production de bile.
- Estomacs sensibles : Les personnes avec un estomac fragile ou irrité devraient l'utiliser avec prudence.
- Allergies : Des réactions allergiques, notamment une dermatite de contact, peuvent survenir, surtout dues aux lactones sesquiterpéniques présents dans le latex de la plante.
Pourquoi boire de la tisane de pissenlit ?
La tisane de pissenlit est recommandée pour plusieurs raisons :
- Effets dépuratifs et diurétiques : Aide à éliminer les toxines du foie et du corps et à réduire la rétention d'eau.
- Aide à la gestion du poids : Peut soutenir les efforts de perte de poids en raison de ses propriétés légèrement laxatives.
- Santé digestive : Favorise une bonne digestion et prévient les troubles comme les ballonnements et les indigestions.
Le saviez-vous ?
Le nom vernaculaire du Taraxacum “Pisse au lit” est une référence à ses propriétés diurétiques.
Son nom latin lui a été donné par les apothicaires à la fin du Moyen Âge. Ce nom est inspiré par le nom arabe du laiteron : “tarakhchakon”. La première mention de l’usage thérapeutique de cette plante a été retrouvée dans des livres de médecine traditionnelle arabe.
L’étymologie du nom latin évoque également le mot grec “Taraxos” qui veut dire “désordre” ou “troubles de la vue”. “Akos” signifie “remède”.
Autrefois, le pissenlit servait de présage aux jeunes filles à marier. Le nombre de fois qu’elles étaient obligées de souffler pour disperser la boule de fruits correspondait au nombre d’années qu’elles étaient destinées à attendre leur futur époux.
Ce n’est qu’à partir du XVIIème siècle que le pissenlit commence à être utilisé pour ses propriétés diurétiques et son action bénéfique sur le foie.
Découvrez nos autres articles au sujet du Pissenlit
- Comment faire une teinture mère de Pissenlit ?
- Comment faire mes gélules de Pissenlit ?
- Les meilleures tisanes pour la digestion !
- Recette : Tisane Pissenlit
- Infusion et tisane : Pissenlit, utilisations
- Tisane Calculs biliaires
- Tisane Détox Foie
- Tisane cellulite aqueuse
- Tisane cellulite fibreuse
- Tisane chute de cheveux
Bibliographie
Karine Jacquemard, naturopathe-herbaliste, Le guide de la phytothérapie au quotidien, Rusticas Editions,2019 | Dr Claudine Luu, 1000 remèdes à faire soi-même, Le guide Terre vivante, octobre 2021 | Dr Eric Lorrain, Grand manuel de phytothérapie, Les nouveaux chemins de la santé, Dunod, 2019 | Yves Vanopdenbosch, Herba Médicinalis, 210 monographies de plantes médicinales, Amyris, 2022 | Dubray Michel, Guide des contre-indications des principales plantes médicinales, Lucien Souny, 2018 | Morel Jean-Michel, Traité pratique de phytothérapie. Remèdes d'hier pour médecine de demain, Grancher, 2008 | Mulot Marie-Antoinette, Secrets d'une herboriste, Dauphin, 2009 | Loïc Ternissen, Le guide Ultime de l'Herboristerie, Albin Michel, 2022 | Mulot Marie Antoinette, Les 250 réponses de l'herboriste, Dauphin, 2009 (1993) | Anne McIntyre, Le guide complet de la Phytothérapie, Le courrier du Livre, 2011 | Carole Minker, 200 plantes qui guérissent, Larousse, 2015 | Thierry Folliard, herboriste et naturopathe, Le petit Larousse des plantes qui guérissent, 500 plantes et leurs remèdes, 2016 | Maria Treben, Les simples du jardi de Dieu, Pratique des plantes médicinales pour bien-être et santé, Ennsthaler, 2007 | Christophe Bernard, Grand manuel pour fabriquer ses remèdes naturels, Jouvence Editions, 2018 | www.altheaprovence.com | www.wikiphyto.org | www.doctissimo.fr | www.vidal.fr
Les informations contenues dans ce texte ne visent pas à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque. Les allégations concernant les bienfaits des plantes et des produits à base de plantes sont basées sur l'utilisation traditionnelle. Rédigé par un rédacteur scientifique pour le grand public, cet article présente l'état actuel des connaissances concernant le sujet abordé lors de sa mise à jour. Les progrès futurs en sciences pourraient rendre cet article partiellement ou totalement obsolète. Il ne doit pas être considéré comme une alternative aux recommandations de votre médecin ou pharmacien.